Définitions
- L’événement traumatique : est un événement brutal, soudain et imprévisible qui menace la vie (intégrité physique et/ou psychique). Il provoque une angoisse majeure de peur et un sentiment d’impuissance. Il peut susciter d’autres émotions fortes comme l‘effroi, l’affolement, la colère, la culpabilité et/ou la honte.
- Le psychotraumatisme : est le phénomène d’effraction du psychisme et de débordement des défenses à la suite de l’événement traumatique (dit aussi traumatogène). Il est finalement la réponse du psychisme à l’événement et se caractérise par l’apparition de symptômes.
Typologies
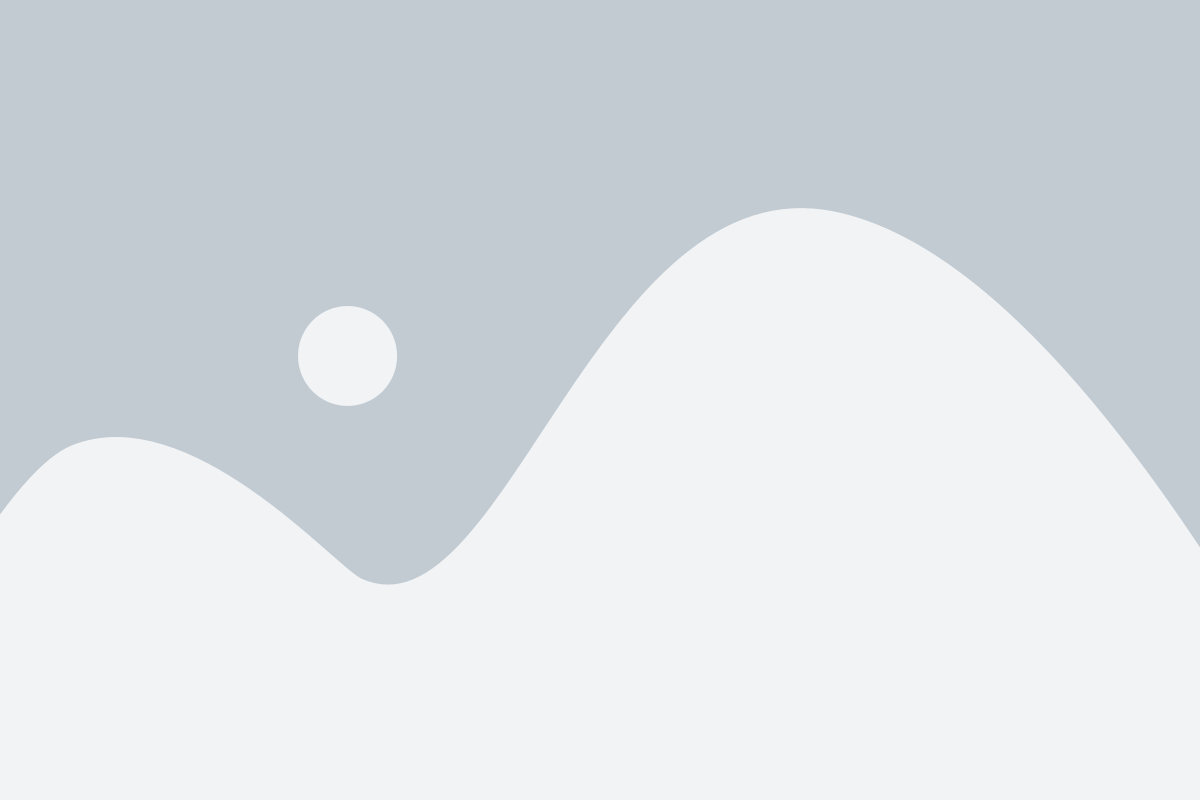
Psychotraumatisme de type I ou de type II (Léonore Terr, 1991) : On parle de psychotraumatisme de type I lorsqu’il est la conséquence d’un événement unique, soudain, inattendu avec un commencement net et une fin précise. Comme par exemple un accident ou une agression. Tandis qu’on parle de psychotraumastime de type II lorsqu’il est la conséquence d’événements répétés, présents constamment ou menaçants à tout instant. Par exemple dans les cas de faits de guerre ou de violences intrafamiliales.
Psychotraumatisme simple ou complexe (Judith Herman, 1992): Cette catégorisation renvoie à la précédente. On parle de psychotraumatisme simple lorsqu’il est la conséquence d’un événement unique, imprévisible et brutal et de psychotraumatisme complexe lorsqu’il est la conséquence de plusieurs événements, répétés ou prolongés, qui se chevauchent et se mêlent entre eux.
Psychotraumatisme direct ou indirect : On parle de psychotraumatisme direct lorsqu’il est la conséquence d’une exposition « en direct » à l’événement, par exemple la victime, le témoin ou l’auteur d’un accident de la voie publique. Tandis qu’on parle de psychotraumatisme indirect lorsqu’il est la conséquence d’une exposition « secondaire » à l’événement traumatique, par exemple l’entourage d’une victime d’un accident de la voie publique. Il peut vulgairement être appelé » psychotraumatisme par procuration ».
Comment ça marche ?
Le système nerveux en situation normale
Le système nerveux en situation traumatique
En commun
1. Perception d’un danger
2. Le cerveau envoi un signal de danger
3. Activation de l’amygdale cérébrale
4. Activation du système nerveux et de l’axe hypothalamus-hypophysaire-surrénalien
5. Sécrétion d’adrénaline et de cortisol pour faire face au danger
6. Augmentation du rythme cardiaque et respiratoire pour faire face au danger
Différences
7. Transmission de données pour prendre une décision
8. Mémoire émotionnelle de l‘événement puis mémoire autobiographique
STRESS ADAPTÉ
7. Le cortex n’arrive pas à trouver de solution face à une situation qui ne lui est pas représentable, il est dépassé, sidéré
8. Face au risque de surchauffe et de surproduction d’hormones de stress, le cortex préfrontal (comme un disjoncteur) va libérer des substances anesthésiantes
9. Par cette voie, l’amygdale n’a plus de liaison avec l’hippocampe, le souvenir ne peut pas faire le chemin habituel et reste bloqué en mémoire émotionnelle
STRESS DEPASSÉ
Les temps cliniques
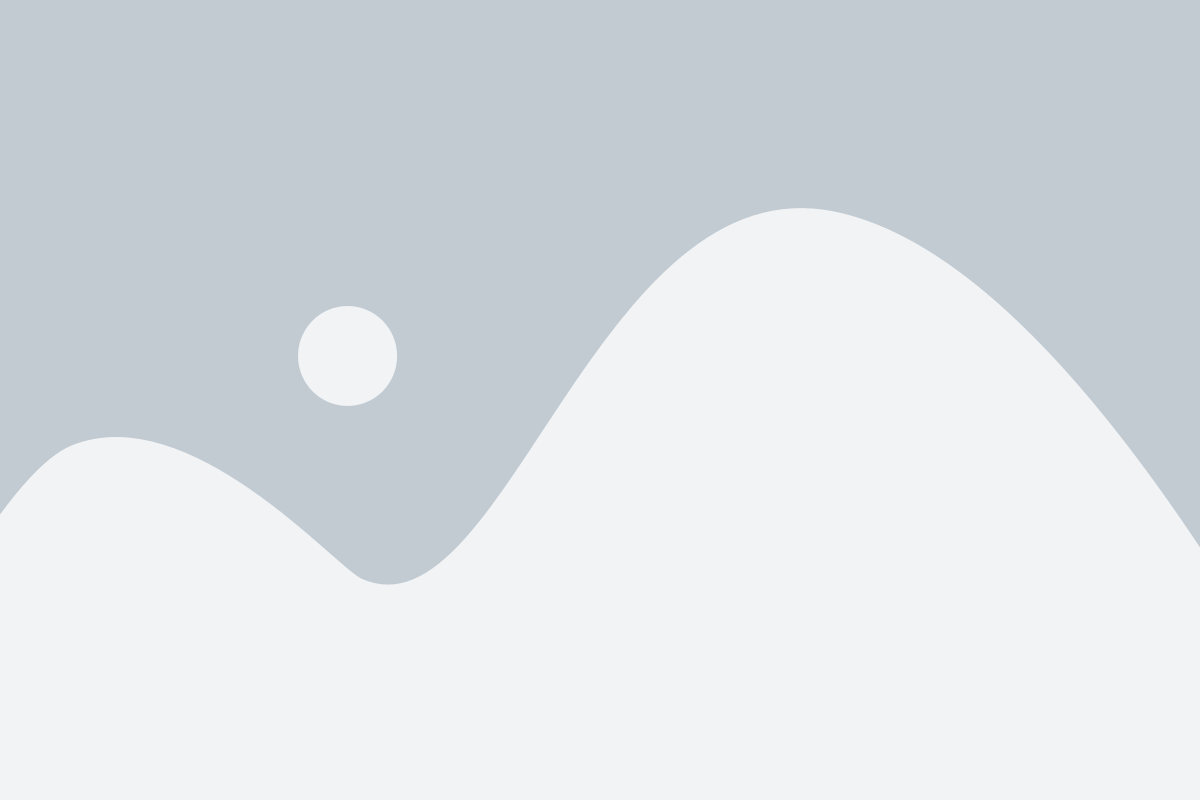
Réactions immédiates et pendant les premiers jours : le stress dépassé se caractérise par l’apparition d’états d’agitation (hyperactivité stérile), de sidération, de dissociation, de dépersonnalisation et de déréalisation ainsi que la mise en place de comportements automatiques.
Dans le mois suivant l’événement : on parle alors de trouble de stress aigu, il se caractérise par l’apparition d’une hypervigilance, d’un évitement des rappels, d’intrusions (flash-backs et reviviscences), de dissociation, de difficultés mnésiques (amnésie ou hypermnésie) et d’une humeur négative.
Persistance à plus d’un mois (avec expression parfois retardée) : on parle alors de trouble de stress post-traumatique, il se caractérise par la répétition (flash-back, reviviscence, cauchemar, réactions physiologiques), l’évitement tant interne (des pensées, des émotions) qu’externe (lieux, personnes, objets rappelant l’évènement), d’une altération de l’éveil et de la réactivité (difficultés de sommeil, de concentration, hypervigilance, irritabilité, autodestruction) et d’une altération des pensées et de l’humeur (croyances, état émotionnel négatif, détachement).